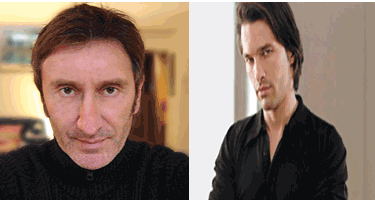 Une fois n’est pas coutume je vais reproduire un arrêt de cassation in extenso car ce dernier semble bien sonner la fin de l’affaire FUZZ. Pour mémoire, c’est votre serviteur qui avait plaidé (oui cela m’arrive
Une fois n’est pas coutume je vais reproduire un arrêt de cassation in extenso car ce dernier semble bien sonner la fin de l’affaire FUZZ. Pour mémoire, c’est votre serviteur qui avait plaidé (oui cela m’arrive ![]() ) le dossier en référé contre le vindicatif Olivier Martinez, (dit aussi le « serial noceur » ou le « traiteur intraitable » mais je m’égare ! ). Bref nous avions perdu en référé face à un magistrat considérant le site FUZZ et la société BLOOBOX d’Eric comme un éditeur de contenu, de ce fait pleinement responsable de ce qu’il publiait (l’annonce du mariage de MARTINEZ et de la mère MINOGUE, tout de suite moins classe dit comme ça). Pour les arguments développés, je vous renvoie à mes billets de l’époque.
) le dossier en référé contre le vindicatif Olivier Martinez, (dit aussi le « serial noceur » ou le « traiteur intraitable » mais je m’égare ! ). Bref nous avions perdu en référé face à un magistrat considérant le site FUZZ et la société BLOOBOX d’Eric comme un éditeur de contenu, de ce fait pleinement responsable de ce qu’il publiait (l’annonce du mariage de MARTINEZ et de la mère MINOGUE, tout de suite moins classe dit comme ça). Pour les arguments développés, je vous renvoie à mes billets de l’époque.
Toujours est-il que fort d’une remise en cause de l’application de la LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique) vis à vis de ceux que j’appelle les « fournisseurs de services web », l’appel de l’affaire (que je n’ai pas géré, lisez ici pourquoi…) fut plus faste, les magistrats écartant la responsabilité de Bloobox. Il ne restait donc plus que la cassation quasiment souhaitable pour l’ensemble de l’internet français afin de clarifier l’application de la LCEN une bonne fois. Certes, personne ne tremblait vraiment mais on préfère que cela soit passé.
En résumé la Cour reconnait qu’un site qui ne fait qu’offrir un réceptacle à des informations qui émanent de tiers n’est pas un éditeur. En conséquence, étant donné que le choix est binaire dans la loi, la société qui gère ce site ne peut être qu’un hébergeur. A tout le moins, je le lirais plus en ce sens : « Ce site est un service qui doit bénéficier du régime de responsabilité allégée des hébergeurs, à défaut d’en être vraiment un au sens de la loi ». Les magistrats usent de leur pouvoir d’interprétation pour faire rentrer ces prestataires dans une case qui convient parfaitement dans ses effets mais non dans sa définition. La position est donc fragile et il est salutaire que ce soit la Cour de cassation qui l’affirme.
Je note par ailleurs la reprise des notions de structuration et de classification des informations. Paradoxalement, ces mêmes critères me valurent jadis de voir BlooBox qualifié d’éditeur au motif que cette structuration ( le fait de créer des thèmes pour classer les informations postées) constituait un « choix éditorial ». Argument affligeant si l’on considère que les catégories couvraient tout ce qui existe en ce bas monde et n’incitaient donc aucunement à la publication d’un type de contenu en particulier (les news people au hasard). Oui je suis content de ne pas avoir écrit d’âneries dans mes conclusions même des années après ! ![]()
Globalement cette décision (et d’autres actuelles) lève donc le danger qui planait sur ce type de prestataires de services Web 2.0 qui ne font que gérer le contenant sans tout à fait voir le contenu. Mais je les invite cependant à une grande prudence. En effet, la rédaction de cet arrêt laisse entendre que la Cour d’appel aurait pu chercher à estimer du rôle actif ou non du prestataire sur le contenu, pour peu que la partie adverse le lui ait demandé et lui ait fourni les moyens de mener une vraie analyse de fond. Il n’est donc pas à exclure qu’une telle analyse du « rôle actif » de notre prestataire puisse déboucher sur une qualification d’éditeur. La question demeure alors : cela aurait-il changé le résultat d’Appel si la Cour avait effectivement dû se prononcer sur le fait de savoir « (…) si, au regard de son activité limitée, la société Bloobox-net ne pouvait ignorer la présence des informations en cause sur son site internet (…) » ?
Il y a en fait deux éléments à observer : 1/ la nature du service, 2/ la connaissance objective du fait litigieux. En résumé pour être certain de ne pas être inquiété il faut cumuler 2 conditions :
- être un service qui par nature ne suppose pas une implication dans la réalisation ou le choix du contenu traité => là se joue la distinction hébergeur / éditeur;
- ne pas laisser des indices qui laissent entendre que dans les faits vous étiez effectivement informé des faits litigieux => là se joue la connaissance effective du fait préjudiciable et la confirmation du statut pressenti.
Mais je me demande aussi si les deux critères ne peuvent pas se mélanger. Ainsi, le prestataire qui par son comportement actif rendrait prouvable sa connaissance des informations en cause, pourrait ainsi remettre en cause la neutralité de son service semblant pourtant a priori structurelle, et ainsi son fragile statut d’hébergeur. Je reste donc sur l’idée que concernant ce type de fournisseurs de services web participatif, le cas par cas va rester de mise faute d’un texte légal adapté.
Gérald SADDE – Avocat par cas
>>> L’arrêt en question <<<
Arrêt n° 164 du 17 février 2011 (09-13.202) – Cour de cassation – Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) : M. O… X…
Défendeur(s) : La société Bloobox-net
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bloobox net a créé sur internet un site accessible à l’adresse www.fuzz.fr sur lequel sont diffusées des informations ; que le 31 janvier 2008 a été publiée sur ce site, une brève rédigée en ces termes : « K… Y… et O… X… réunis et peut-être bientôt de nouveau amants », accompagnée d’un titre « K… Y… et O… X… toujours amoureux, ensemble à Paris », lui-même assorti d’un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site www.célébrités-stars.blogspot.com ; qu’invoquant une atteinte à sa vie privée, M. X… a saisi le juge des référés pour voir obtenir réparation et retrait immédiat de l’article sous astreinte ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, (Paris, 21 novembre 2008) statuant en matière de référé, d’avoir débouté M. X… de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en matière de communication au public par voie électronique, la responsabilité de l’éditeur de contenus relève du droit commun de la responsabilité des éditeurs ; qu’en revanche, la responsabilité du fournisseur d’hébergement ne peut être engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire des services qu’il fournit, s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ; que le fournisseur d’hébergement est celui qui assure le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ; que celui qui contrôle un site internet, sur lequel il diffuse des informations ou autorise des tiers à y inscrire des informations, a la qualité d’éditeur et non de fournisseur d’hébergement, de sorte que sa responsabilité relève du droit commun de la responsabilité des éditeurs et non du droit spécial de la responsabilité des fournisseurs d’hébergement en matière de communication en ligne ; qu’en décidant néanmoins que la société bloobox-net, qu’elle a elle-même qualifiée d’”éditrice du site www.fuzz.fr”, ne pouvait être considérée comme un éditeur, au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, de sorte que sa responsabilité relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, au motif inopérant que les internautes peuvent entrer directement des informations sur le site internet et, notamment, y insérer des liens vers d’autres sites, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ensemble les articles 9 et 1382 du code civil, et l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement, les personnes qui assurent, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services, si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ; qu’en se bornant à relever que M. X… n’avait pas mis la société Bloobox-net en demeure de retirer de son site internet les données litigieuses, sans rechercher si, au regard de son activité limitée, la société Bloobox-net ne pouvait ignorer la présence des informations en cause sur son site internet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’activité de la société Bloobox net, créatrice du site www.fuzz.fr, se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l’usage de son service mais que cette société n’était pas l’auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en a exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ; qu’ainsi la cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Gaschignard

