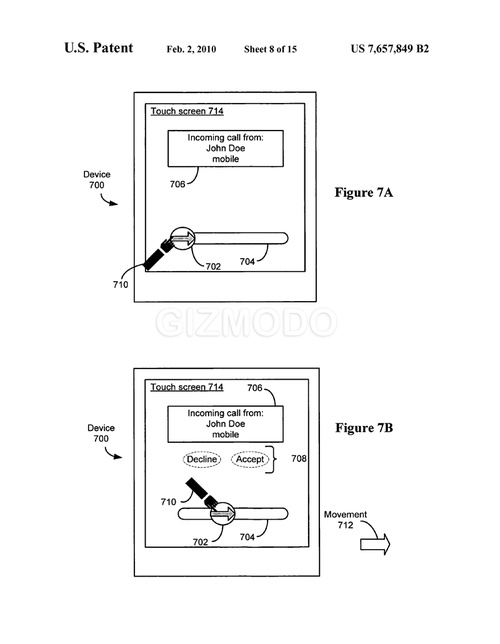V. Yakobchuk
Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 14 janvier 2010, Télécom Italia (Tiscali) contre Dargaud Lombard, Lucky Comics. Voilà une décision à ne pas oublier ! Pourquoi je dis ça moi ? Vous allez l’oublier…
De quoi retourne-t-il ? Et bien nous replongeons une fois de plus dans ce blog dans l’épineuse question de la responsabilité des hébergeurs. Plus exactement, la question serait plutôt : jusqu’où peut-on se considérer comme un hébergeur, et bénéficier à ce titre du régime responsabilité protecteur prévu par la loi ?
En apparence il s’agit d’ une décision comme les juristes les aiment. C’est une vraie jurisprudence qui dit bien ce qu’elle a à dire. En lisant le résumé sur Legalis.net, j’ai commencé à me frotter les mains en me disant que c’était trop beau, trop évident, qu’il y avait certainement un petit mot sur lequel rebondir, une référence à laquelle réagir, une incohérence à brandir. Je n’ai plus de verbe en « …ir ». Mais je n’y ai finalement trouvé qu’une interprétation très sèche d’un texte de loi. la Cour avait tranché ! Mais justement, à bien y regarder l’intérêt de cet arrêt ne réside pas dans les subtiles nuances de sa rédaction. Au contraire il doit être considéré très basiquement : les conséquences de cette décision semblent graves … Et s’il doit il y avoir discussion ce n’est pas sur la motivation ou la qualité du raisonnement que l’on y trouve. L’objet du discours se doit d’être engagé : la Cour de Cassation a-t-elle eu raison ou tort ?
Reprenons les faits :
Un internaute a décidé de créer un site dédié à la bande dessinée et a mis en ligne la reproduction intégrale des vignettes de l’album » Les aventures de Black et Mortimer : le secret de l’Espadon » ainsi qu’un Lucky Luke ( « le Daily star »). Ledit site était hébergé via un hébergement gratuit « chez.com », service assuré par la société Tiscali media (aujourd’hui Télécom Italia).
Les éditeurs ont donc cherché à assigner le créateur du site qui bien entendu avait fourni de fausses informations d’authentification. Le contrefacteur tombe à l’eau, qu’est-ce qui reste ? Notre bon hébergeur bien entendu !
Ces faits sont anciens et datent d’avant la promulgation de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique en juin 2004 (LCEN) et de son fameux article 6-I. La Cour se doit donc de se référer à l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 (modifiée sur ce point par une loi du 1er août 2000) en vigueur au moment des faits. Néanmoins, j’ai toujours considéré que le mécanisme de ces deux textes était semblable pour ne pas dire strictement identique. En effet, le principe n’a pas changé suite à la transposition de la directive :
1/ Les hébergeurs n’ont pas d’obligation générale de surveillance du contenu hébergé car il n’en sont pas éditeurs.
2/ Ils doivent agir promptement une fois valablement informé d’un problème sur une page qu’ils hébergent (je fais un petit raccourci car les modes de cette information ont changé tout de même)
3/ Seul le fait de ne pas agir en face de faits manifestement illicites engage leur responsabilité.
Oui mais voilà, la Cour tranche la question en amont de ce mécanisme, puisqu’elle refuse à TISCALI la qualité d’hébergeur et le bénéfice de cette responsabilité limitée. Pourtant, techniquement parlant, TISCALI est manifestement un hébergeur qui offre de l’espace disque. La Cour ne l’entend pas ainsi et au contraire estime que Tiscali s’est comporté en éditeur de contenu, c’est à dire la qualification exactement opposée. La Cour reprennant le raisonnement des magistrats d’appel, se fonde sur la publicité présente sur le site et qui permet tout simplement de rentabiliser le service.
En résumé, afin de vous expliquer l’ampleur potentielle de la décision, cela signifie que tout prestataire de service en ligne type web 2.0, qui fournit un service gratuit aux internautes et qui se rémunère par l’affichage de bandeau publicitaire, ne peut plus prétendre à la qualité d’hébergeur. Cet argument de la publicité n’est pas nouveau. On le voit souvent évoqué dans les décisions comme étant une preuve de l’implication de l’hébergeur dans le contenu du site. Mais c’est la première fois que la Cour de cassation consacre cet argument que j’appellerai de « l’intérêt financier ». Est-ce dire que l’hébergeur rompt la neutralité vis-à-vis du contenu qu’il héberge et qui le protège, dès lors qu’il tire un intérêt financier de ce contenu fut-il indirect comme en matière de publicité ?
Finalement, l’hébergeur tire des profits de ce que les internautes viennent lire en nombre un contenu contrefaisant … Tout cela semble logique mais faut-il s’arrêter là sachant que la loi qui vient protéger les hébergeurs a pour objectif de ne pas les rendre responsables de faits dont ils ne peuvent avoir connaissance puisque n’étant pas auteur du contenu ? Notons bien qu’il est évident que l’hébergeur doit être responsable du contenu des publicités qu’il impose au créateur du site.
La Cour est pourtant très directe en affirmant qu’en proposant « aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle (Tiscali) assurait la gestion » (…), « les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986« . Le coup est rude !
Je souhaite mettre en parallèle cet extrait d’un arrêt de la Cour d’Appel de mai 2009 que j’avais commenté et qui émane de la même 4 ème chambre de la Cour d’appel de Paris qui a jugé notre affaire. Un mois avant, pour des faits quasi similaires, la Cour nous propose une explication inverse que j’avais déjà commenté et que je reproduis ici in extinso tant elle me semble précise et claire :
« (…) l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires, dès lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, n’est pas davantage de nature à justifier de la qualification d’éditeur du service en cause ; Qu’il importe d’observer à cet égard, que la LCEN dispose que le service hébergeur peut être assuré même à titre gratuit, auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et qu’elle n’édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l’exploitation commerciale d’un service hébergeur au moyen de la publicité ; »
Alors pourquoi cette différence de traitement d’une affaire à l’autre ? Il faut sans doute s’intéresser à la modification de la définition légale de l’hébergeur. Juqu’en juin 2004, les hébergeurs sont « Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services« . Depuis la LCEN les hébergeurs sont « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services (…) ». La notion de « stockage direct et permanent » a disparu de la nouvelle définition. La Cour de cassation aurait-elle interprété de manière très restrictive le terme « direct » ? Cela est possible et je rejoins là l’avis de Monsieur Lionel THOUMYRE (Juriscom.net) qui veut y voir une chance d’amoindrir la porté de cet arrêt en le réduisant à l’interprétation d’un texte qui n’a plus cours.
Mais force est d’admettre que l’indice est mince surtout si l’on considère que le terme « direct » a bien des significations plus évidentes que celle proposée par la Cour. En quoi le fait de financer le service par la publicité rend la prestation indirecte sachant que la gratuité du service d’hébergement est expressément admise ? Le terme direct ne sert-il pas simplement à distinguer le perstataire technique qui héberge des intermédiaires potentiels qui pourraient en commercialiser les services par exemple. Tout comme le terme « permanent » visait certainement à faire une distinction avec d’autres prestataires techniques gérant des infrastructures pouvant assurer des stockages temporaires d’information (Fournisseur d’accés, gestionnaires de point d’échange de traffic etc.).
Tout cela ne tient pas, la différence entre les deux textes est trop ténue et je ne vois pas ce qui pourrait empêcher la Haute Cour de faire le même choix avec pour fondement la LCEN. Car il s’agit bien d’un choix et non d’un raisonnement, ce qui est triste quand ce choix semble bien peu judicieux, même si pour certains, juridiquement parlant, la Cour ne fait qu’avoir une interprétation stricte d’une exception, ce qui est la règle. Pour ma part, la Cour de cassation a clairement réintroduit une responsabilité là où la loi n’en voulait pas. Au risque de distinguer là où il n’y a pas lieu, en interprétant strictement la notion d’hébergeur, la Haute Juridiction n’apprécie pas strictement les conséquences de l’exception mais elle restreint drastiquement le champ de ceux qui peuvent en être bénéficiaires. Elle attaque ainsi le maillon le plus faible du mécanisme de responsabilité limitée et ouvre la boite de Pandore aux autres juridictions. Car il existe bien d’autres actions et services qui peuvent remettre en cause la neutralité de l’hébergeur vis-à-vis du contenu. Or tout ce dispositif vise à éviter une obligation de surveillance permanente sur un contenu que les hébergeurs ne maîtrisent pas. Mais la responsabilité de l’hébergeur ne disparaît en aucun cas.
Finalement, soit la cour vient de mettre en place un régime de responsabilité sans faute, soit elle ajoute à la loi en recréant le principe de responsabilité en cascade.
La dernière solution serait tout simplement qu’il s’agit d’une façon de sanctionner indirectement le manque de vigilance de l’hébergeur quant à l’identification du bénéficiaire de son service. Et sur ce point j’abonde totalement. La première des responsabilité de l’hébergeur doit être de vérifier la véracité des données d’identification du créateur du compte. Ce doit être la contrepartie de la protection légale qui lui est offerte, celle de toujours pouvoir désigner le coupable, s’il ne veut pas l’être lui-même. Est-ce là le message de la Cour ? Je mettrai peut-être à jour cette analyse sur ce point car l’idée d’un arrêt d’espèce ayant pour vrai fondement ce point me paraît plausible.
En tous les cas il est prudent de commencer à réfléchir à la pleine portée de cette décision dans les contentieux à venir.
Je reprends donc pour les cancres du fond qui n’ont pas tout lu : « le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent« . La Cour de cassation a le pistolet, les hébergeurs, eux, commencent à creuser …
Gérald SADDE – Avocat … dubitatif !